Montaigne and the loci communes : practices of reading and writing in the Sixteenth Century
Montaigne et les loci communes : pratiques de lecture et d'écriture au XVIe siècle
Résumé
Our study shows that Montaigne’s rhetoric has some relationships with commonplace-book method, which constitute an important part of school curriculum in the Sixteenth Century, and with the concept of loci communes.The first part describes the history and evolution of rhetorical concept, locus and loci communes, from antiquity to the Renaissance. After studying theories for rhetorical education written by Erasmus and Melanchthon, we outline precisely the mechanism, function and influence of commonplace-books.The second part makes analysis of the use of quotations in the Essays. Montaigne compose them with random order so that the Essays get close to miscellanies. We examine also the use of loci communes of traditional rhetoric in the Essays. Montaigne shows us a fine collaboration of rhetoric and skepticism in the chapter of « Apology of Raimond de Sebonde ». The last part places the Essays on the historical context of the second-half of sixteenth century. We envisage particularly Montaigne’s brevity of style in relation to his preference for writers of the Silver-Latin. Finally, we wish to make it clear Montaigne’s intention and objective of writing, which allow to distinguish the Essays from Commonplace-Books.
Notre étude montre que la rhétorique de Montaigne emprunte à la méthode des lieux communs qui relève du programme scolaire du XVIe siècle, ainsi qu’au concept rhétorique de loci communes.La première partie décrit l’histoire et l’évolution du concept de locus et des loci communes depuis l’Antiquité jusqu’à la Renaissance. En analysant la théorie rhétorique et pédagogique d’Érasme et de Mélanchthon nous préciserons les mécanismes de la composition d’un recueil de lieux communs et l’influence portant sur la rhétorique de la Renaissance.La seconde partie présente d’abord la pratique des citations chez Montaigne, envisageant ensuite la disposition des Essais, dont le désordre nous rappelle le genre des miscellanées. Nous aborderons enfin la mise en œuvre chez Montaigne des loci communes hérités de l’art oratoire traditionnel, ce qui nous montrera une belle contribution de la rhétorique au scepticisme.La dernière partie place Les Essais dans le contexte historique et rhétorique de la seconde moitié du XVIe siècle. Nous aborderons la brièveté du style chez Montaigne, en rapport avec sa préférence pour les auteurs de l’Âge d’argent, et dégagerons l’intention et l’objectif d’écriture de l’essayiste, qui permettent de distinguer Les Essais des recueils de son temps.
Fichier principal
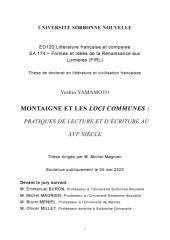 These_YAMAMOTO_Yoshio_2023.pdf (3)
Télécharger le fichier
These_YAMAMOTO_Yoshio_2023_annexes.pdf (786)
Télécharger le fichier
These_YAMAMOTO_Yoshio_2023.pdf (3)
Télécharger le fichier
These_YAMAMOTO_Yoshio_2023_annexes.pdf (786)
Télécharger le fichier
| Origine | Version validée par le jury (STAR) |
|---|
| Format | Autre |
|---|
